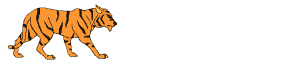Un « Tour du monde aux portes de Paris » pour convaincre les citadins de l’importance de protéger la biodiversité ? La réouverture, prévue le 12 avril, du zoo de Vincennes, avec son millier d’animaux captifs à quelques centaines de mètres du périphérique, ne pouvait se justifier que par un solide projet scientifique et pédagogique.
Au Muséum national d’histoire naturelle, auquel le parc zoologique est rattaché depuis sa création en 1934, la question de savoir si Paris avait réellement besoin de ce projet à 167 millions d’euros n’a pas fait débat. « Cela allait de soi, témoigne Thomas Grenon, directeur général du Muséum depuis 2010. Nous vivons dans un monde où la relation avec la nature se perd. Le zoo urbain est un lieu essentiel pour retrouver ce lien. Celui que nous avons imaginé n’est plus une simple attraction, mais un outil formidable de sensibilisation et un centre de conservation des espèces respectueux de l’animal. »
Education à l'environnement
Plus une simple « attraction », vraiment ? Dans l’esprit de ses concepteurs, c’est certain. Mais pour ses visiteurs, le zoo demeure un lieu de distraction, un but de promenade familial pas très différent de Disneyland Paris. « Les zoos sont censés être des vecteurs de diffusion de culture scientifique et d’éducation à l’environnement, mais les visiteurs viennent dans une optique de loisir », reconnaît Michel Saint Jalme, le directeur de la ménagerie du Jardin des plantes. En 2013, une étude réalisée dans celle-ci a montré que trois personnes sur quatre ne lisent pas les panneaux d’information, tandis que la quatrième ne passe en moyenne que douze secondes devant chacun d’eux…
Difficile de se satisfaire de tels résultats. A Vincennes, d’autres instruments de « médiation » ont donc été imaginés, qui misent sur l’empathie et la curiosité provoquées par la proximité avec l’animal. « J’essaie de faire tomber les idées reçues en valorisant la beauté esthétique ou les particularités comportementales de certaines espèces », raconte Olivier Marquis, responsable des reptiles, des invertébrés et des amphibiens. Aux soigneurs en contact avec le public, il demandera par exemple de raconter la singulière histoire du « crapaud accoucheur ».
« Spectacle de la nature »
L’immersion dans des paysages reconstitués, où les animaux évoluent, sinon en liberté, du moins dans plus d’espace – et donc de confort – que dans leurs antiques cages, est aussi censé toucher le citadin en le plongeant dans le « spectacle de la nature ».
Cinq zones géographiques où les espèces sont menacées à des degrés divers ont été choisies dans ce but : la plaine africaine du Sahel, la Patagonie, Madagascar, la Guyane, mais aussi l’Europe. Dans la serre de 4 000 mètres carrés envahie par une végétation tropicale, près d’une trentaine d’espèces d’oiseaux évolueront en liberté. « Nous voulons réveiller la curiosité naturaliste en chacun des visiteurs », explique Alexis Lécu, le directeur scientifique du zoo.
L’autre raison d’être du parc zoologique de Vincennes repose sur la grande aventure de la conservation, dont il se veut l’un des maillons. Avec son « armée de réserve » de près de 180 espèces, dont la majorité sont inscrites sur la Liste rouge mondiale des espèces en danger de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), le parc zoologique participe à une trentaine de programmes d’élevage en captivité dans le but d’en prévenir l’extinction.
Part de tâtonnement
Si les cas de réintroduction dans la nature sont extrêmement rares, Paris s’enorgueillit d’avoir participé à deux d’entre eux au cours des dernières années : l’oryx gazelle en Arabie saoudite et le cheval de Przewalski en Mongolie.
Discours de la raison, registre de l’émotion… Le Muséum reconnaît une part de tâtonnement dans sa démarche pour que l’idée de protéger la biodiversité touche le plus grand nombre. Les visiteurs ne devront donc pas s’étonner de croiser, à côté des animaux, des sociologues qui sont chargés d’observer leurs réactions.
Forum
Le nouveau zoo de Vincennes fait le pari de la pédagogie
1 message
• Page 1 sur 1
Le nouveau zoo de Vincennes fait le pari de la pédagogie
A défaut de découvrir de visu le "nouveau Vincennes" ce jour (n'est-ce pas Didier,  ), je me contente de mettre en ligne cet article publié par Le Monde dans son édition numérique d'hier :
), je me contente de mettre en ligne cet article publié par Le Monde dans son édition numérique d'hier :
Biofaune : l'actualité de la conservation in & ex situ : http://biofaune.canalblog.com - www.facebook.com/biofaune
- Philippe
- Messages: 11543
- Enregistré le: Lundi 29 Août 2005 16:06
1 message
• Page 1 sur 1
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 19 invités