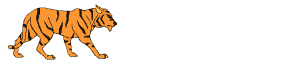A l'occasion de la Conférence de Londres sur le commerce illégal des espèces menacées organisée mercredi 12 et jeudi 13 février à Londres, Philippe Chardonnet, directeur de la Fondation internationale pour la conservation de la faune sauvage, insiste sur la nécessité de lier conservation et développement.
Vétérinaire de formation, il est également membre au sein de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), des groupes d'experts sur les Antilopes d’Afrique et contribue à l’élaboration des Listes rouges des espèces menacées. Philippe Chardonnet travaille actuellement à un projet de translocation des dernières girafes d’Afrique de l’Ouest au Niger.
Vous travaillez depuis les années 1980 en Afrique, quel regard portez-vous sur l’évolution de la grande faune ?
Philippe Chardonnet : J’ai du mal à considérer l’Afrique comme une entité unique. Il existe de très grandes disparités sur le continent. Globalement, nous pourrions dire que nous avons échoué à conserver la grande faune africaine, mais il existe de très nombreuses réussites à l’échelle locale. Deux pays se distinguent : la Namibie et l’Afrique du Sud. Ce sont, pour des raisons différentes, deux grandes success stories : le premier a développé des conservatoires communautaires [depuis 1996, des programmes de protection de l’environnement et de la faune peuvent être directement gérés par des communautés, qui, le cas échéant, en perçoivent les bénéfices] qui sont devenus des expériences modèles et le second a bénéficié d’un engagement du secteur privé dans la conservation qui a permis de financer des projets de grande envergure. En Afrique du Sud, le nombre de rhinocéros est par exemple plus important dans les réserves et les ranchs privés que dans les parcs nationaux.
Et ailleurs ?
Il y a des réussites, mais elles sont fragiles. Dès que les initiateurs des projets quittent le terrain, le risque est grand de les voir péricliter. La conservation crée encore trop souvent des ennemis de la conservation. Elle génère de l’exclusion et de la coercition pour les communautés locales. C’est parfois inévitable pour obtenir des résultats à court terme mais, sans projet de développement, cette conservation n’est pas durable. La répression ne règle pas le problème de pauvreté sur lequel prospère le braconnage.
Pour être acceptée, la conservation doit-elle « rapporter » ?
Oui, mais pas nécessairement de l’argent. Les projets de conservation peuvent être synonymes d’emplois pour les communautés locales, de ressources en viande… La superficie des grands espaces va diminuer. C’est inéluctable. La démographie du continent va doubler d’ici à 2050. L’anthropisation des milieux est en marche. Ces pays veulent se développer et c’est normal. Mais si nous voulons pouvoir préserver ce qu’il reste de la grande faune, il faut imaginer une utilisation de l’espace où chacun vive en bonne intelligence. Il n’a pas de modèle unique.
Plusieurs Etats africains ont eu recours récemment à des opérations de translocation pour éviter des extinctions locales d’espèces, est-ce une solution ?
La translocation est une solution technique. Elle est toujours possible dès lors que l’espèce n’a pas disparu, mais elle est très coûteuse. Bien plus en tout cas que de préserver maintenant ce qui existe. Dans la réserve nationale de Gilé, au Mozambique, nous avons réussi à réintroduire une faune qui avait été décimée par des décennies de conflits. Nous avons faire revenir près d’une cinquantaine de buffles, vingt gnous, une quinzaine de zèbres. La disparition de la grande faune n’est donc pas une fatalité si les Etats ont cette volonté.
Source : Le Monde.