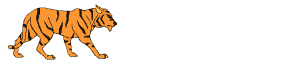source :
http://www.lesechos.fr du 13 Aout 2007
Le tigre victime des pouvoirs qu'on lui prête
Les vertus pseudo-thérapeutiques aussi ancestrales que dénuées de fondements scientifiques pèsent sur l'avenir du seigneur de la jungle.
Avec un nom sonnant comme une attaque commando, l'« Opération tigre » est peut-être en passe de gagner la guerre contre la disparition de l'espèce la plus emblématique de la faune sauvage. Initiée en 1972 par le World Wild Found (WWF) après le constat alarmiste du directeur du zoo de Delhi, la population du tigre du Bengale, l'une des huit sous-espèces de « Panthera tigris », retrouve quelques couleurs :
ces vingt dernières années, le nombre d'individus à l'état sauvage a plus que doublé, passant en Inde de 1.800 à 4.300 en dépit de la pression démographique (la population s'étant accrue de plus de 300 millions d'habitants, et le nombre de têtes de bétail de 100 millions pendant la même période).
L'espèce revient de loin : « Jusqu'au début du XXe siècle, le prédateur occupait une zone qui allait de la Turquie vers l'est en traversant toute l'Asie à l'exception du plateau tibétain », raconte le guide naturaliste Gérard David, qui accompagne des groupes de touristes dans le parc national de Kanha, l'un des sanctuaires de la vie sauvage créés sous la pression du WWF. On en dénombrait alors près de 100.000, dont presque la moitié en Inde. Depuis, les chasses royales, la traque des villageois et le passe-temps des colons ont eu raison de trois sous-espèces : celui de Bali éteint dans les années 1940, celui de la Caspienne disparu dans les années 1970, et le tigre de Java, disparu dans les années 1980.
« A présent, le félidé n'occupe plus que 7 % de son territoire d'origine », vient de calculer le WWF et plusieurs sociétés de conservation de la faune après une vaste étude conduite par 160 chercheurs à l'aide d'images satellite, d'informations récoltées sur le terrain et de cartes recensant l'occupation humaine du sol. « C'est bien moins que ce qu'on croyait jusqu'ici », se désole Roland Melisch, une des références mondiales sur la connaissance du félidé. « Depuis 1995, explique-t-il, le nombre de régions qui abritent le tigre a diminué de 40 %, mais il n'est pas trop tard pour agir. » Les scientifiques ont en effet découvert quatre grands habitats abritant chacun plus de 500 tigres (1) et 76 régions où il subsiste encore. « Pour peu que les milieux concernés jouent le jeu, ce sont autant de perspectives pour l'animal. » analyse Roland Melisch.
Mangeur d'hommes
Après trente ans de militantisme, les promoteurs d'« Opération tigre » veulent y croire. Leur programme de préservation a récolté plus de 30 millions de dollars pour sauver l'espèce. Il supervise 37 projets nationaux et plusieurs autres programmes transrégionaux à l'extrémité orientale de la Russie et dans le Sud-Est asiatique. « Notre objectif n'est pas seulement de renforcer le réseau d'aires protégées, explique le coordinateur du réseau Traffic (2) en France, Stéphane Ringuet.
Il s'agit aussi de réduire la demande de produits issus de tigres, notamment en coopérant avec les praticiens de la médecine traditionnelle asiatique, et d'aider à limiter les conflits entre les populations locales et le félin. » Après des années de tâtonnement dans cette science nouvelle à mi-chemin entre l'écologie et l'anthropologie, les experts savent maintenant que, pour qu'un programme de préservation réussisse, il doit intégrer des stratégies de sauvegarde des écosystèmes et prendre en compte les besoins des populations locales. « Difficile de convaincre un paysan de protéger un animal qui dévore son bétail », explique Arnaud Greth, directeur scientifique du WWF France. A fortiori, s'il attaque aussi l'homme. Amateur de cervidés, de sangliers, et même de crocodiles, d'oiseaux, de singes et de poissons, le tigre est aussi amateur de chair humaine : en trente ans, il a tué ou dévoré au moins 550 personnes, entretenant par là même le sentiment de terreur qu'il inspire aux populations.
Les réseaux de trafiquants ont saisi l'opportunité de cette antipathie pour braconner impunément le félin. Ces dernières années, le problème a même pris des proportions démesurées, passant de l'abattage artisanal isolé à l'« industrialisation criminelle », au point que le gouvernement indien a délégué des pouvoirs spéciaux au Central Bureau of Investigation pour tenter d'enrayer le massacre. « Le nombre de saisies effectuées est alarmant, et il n'est que la partie immergée de l'iceberg », constate Stéphane Ringuet. Les évaluations les plus pessimistes estiment entre 200 et 300 le nombre de bêtes abattues chaque année par les trafiquants. Rien qu'en Corée, qui dispose des statistiques les plus fiables, 6.200 kilos d'os de tigre ont été importés entre 1975 et 1992, l'équivalent de 600 à 1.000 bêtes.
Commerce lucratif
Venue de Chine et du Japon surtout, la demande en « pièces de tigre » explose. Tout se monnaie : la queue, broyée et mélangée avec du savon pour obtenir un onguent prétendument efficace contre le cancer de la peau ; les os, broyés et mélangés à du vin pour fournir une boisson soi-disant tonique à Taiwan ; la peau, qui guérirait d'une fièvre causée par les fantômes ; les poils, qui écartent les dangereux scolopendres quand ils sont brûlés ; les prunelles servant de remède contre les convulsions ; le cerveau, mêlé d'huile, pour lutter contre la paresse ; les griffes, crocs et côtes servant de talismans porte-bonheur ; les calculs biliaires, appliqués avec du miel, pour traiter les abcès sur les mains et les pieds... « Pour 230 dollars, certains restaurants chinois proposent même de consommer le coeur ou le pénis du tigre préparés en soupe si on veut accroître ses performances sexuelles et se donner force et courage », rapporte un employé de la Wildlife Protection Society of India (WPSI) cité par le magazine indien « Outlook ».
Ce commerce très lucratif a transformé l'Inde, qui abrite 60 % de la population sauvage de tigres, en vaste terrain de chasse. « Trente ans d'efforts risquent d'être ruinés », redoute
le WWF, qui veut désormais concentrer sa stratégie de sauvetage sur quatre actions prioritaires : la conservation transfrontalière des quatre principaux habitats qui viennent d'être identifiés ; la protection accrue de dix autres régions, la création de corridors de circulation pour relier les habitats les plus isolés et lutter ainsi contre le risque d'appauvrissement génétique et la vulnérabilité de l'espèce aux catastrophes naturelles ; enfin une aide ciblée à la propagation des spécimens les plus aptes à la reproduction.
En filigrane, la pression internationale se précise pour presser le gouvernement indien d'appliquer les lois qu'il a votées. Montré du doigt, son laxisme est jugé par la communauté des chercheurs comme le principal responsable de l'organisation de filières criminelles. Une poignée seulement de chasseurs ont été condamnés pour avoir tué des tigres, et jamais la peine maximale de sept ans de prison prévue pour ce délit n'a été prononcée. Le braconnage est désormais la deuxième activité illégale du pays derrière le trafic de drogue.
(1) Aux confins de la Russie et de la Chine, dans la plaine du Teraï entre l'Inde et le Népal, dans la forêt de Namdapha-Manas entre le Bhoutan, le Myanmar et l'Inde, et dans la province du Tenasserim entre le Myanmar et la Thaïlande.(2) Traffic est le réseau de surveillance du commerce d'espèces sauvages auprèsdu World Wild Found.