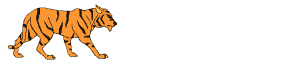Ca a l'air d'un parc très joli, dommage pour les volières.
Forum
Parc zoologique de Clères
34 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Parc zoologique de Clères
Ca me rappelle Branféré. 
Ca a l'air d'un parc très joli, dommage pour les volières.
Ca a l'air d'un parc très joli, dommage pour les volières.
-

Thibaut - Messages: 2028
- Enregistré le: Mercredi 26 Juillet 2017 14:37
Re: Parc zoologique de Clères
Thibaut a écrit:Ca me rappelle Branféré.
Ca a l'air d'un parc très joli, dommage pour les volières.
Branféré il y a une certaine époque, Château-Sauvage d'Emancé et Clères... Cette semi-liberté avec tout plein de wallabies, d'antilopes cervicapres, de cervidés divers, d'oiseaux de toutes sortes, ces îles à singes était un sacré point commun, et d'après mes souvenirs, ces trois parcs collaboraient beaucoup entre eux.
Par la suite, les chemins se sont peu à peu séparés.
-

Vinch - Messages: 6084
- Enregistré le: Jeudi 22 Octobre 2009 19:49
Re: Parc zoologique de Clères
Branféré il y a une certaine époque
Avant plaine africaine et autres aménagements.
ces trois parcs collaboraient beaucoup entre eux.
Pour château-sauvage je ne sais pas mais je me souviens qu'il y avait d'importants échanges avec le parc de Clères.
-

Thibaut - Messages: 2028
- Enregistré le: Mercredi 26 Juillet 2017 14:37
Re: Parc zoologique de Clères
JulesDomalain a écrit:Les deux groupes de gibbons sont constitués d'un couple, et de leurs petits. Les naissances sont assez fréquentes (tous les deux ans je dirais), et lors de ma dernière visite (en avril), je crois qu'il y avait un jeune chez les favoris roux (mais ils sont très dur à voir sur l'île, donc je ne suis pas sur, et deux chez les favoris blancs, un assez jeune, et un bien plus grand, de 2 ou 3 ans je dirais.
J'essaierais de voir les gibbons sur l'île pour savoir la composition du groupe, et j'essaierais de prendre des photos des individus, comme ça, les spécialistes diront avec plus de précision que moi l'âge des gibbons.
Merci !
- abel
- Messages: 3651
- Enregistré le: Lundi 02 Novembre 2015 18:47
- Localisation: Tours/Rennes
Re: Parc zoologique de Clères
Pour vous faire patienter avant le compte rendu du parc (je n'ai pas mon appareil photo avec moi, donc difficile de le préparer), voici la liste des espèces du parc:
Mammifères:
-Hydropote de Chine (Hydropotes inermis)
-Muntjac de Chine (Muntiacus reevesi)
-Antilope cervicapre (Antilope cervicapra)
-Gibbon à favoris roux (Nomascus gabriellae) —> un couple+ 2 jeunes
-Gibbon à favoris blanc (Nomascus leucogenys) —> un couple + un jeune
-Ouistiti pygmée (Cebuella pygmaea)
-Tamarin empereur (Saguinus imperator)
-Maki catta (Lemur catta)
-Happalémur du Lac Alaotra (hapalemur alaotrensis)
-Panda roux (Ailurus fulgens)
-Wallaby de bennett (Macropus rufogriseus)
Oiseaux:
Ratites:
-Émeu (Dromaius novaehollandiae)
Pelecaniformes:
-Pélican frisé (Pelecanus crispus)
-Ibis sacré (Threskiornis aethiopicus)
-Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax)
-Aigrette garzette (Egretta garzetta)
-Ibis chauve (Geronticus eremita)
-Ibis rouge (Eudocimus ruber)
-Spatule blanche (Platalea leucorodia)
-Saptule rose (Ajaja ajaja)
-Cigogne blanche (Ciconia ciconia ciconia)
Phoenicopteriformes:
-Flamant du Chili (Phoenicopterus chilensis)
Ansériformes:
-Kamichi à collier (Chaune torquata)
-Canaroie semi-palmée (Anseranas semipalmata)
-Dendrocygne des antilles (Dendrocygna arborea)
-Dendrocygne veuf (Dendrocygna viduata)
-Oie céréopse (Cereopsis novaeholladiae novaehollandiae)
-Oie à tête barrée (Anser indicus)
-Bernache nonette (Branta leucopsis)
-Bernache cravant (Branta bernicla)
-Oie empereur (Anser canagicus)
-Oie rieuse (Anser albifrons)
-Bernache de Hutchins (Branta hutchinsii minima)
-Grande bernache du Canada (Branta canadensis maxima)
-Bernache néné (branta sandvicensis)
-Oie des neiges (Anser caerulescens)
-Oie naine (Anser erythropus)
-Bernache à cou roux (Branta ruficollis)
-Oie de Ross (Anser rossii)
-Cygne noir (Cygnus atratus)
-Cygne à col noir (Cygnus melancoryphus)
-Tadorne d’Australie (Tadorna tadornaides)
-Tadorne casarca (Tadorna tadorna
-Tadorne de Belon (Tadorna ferruginea)
-Tadorne d’Afrique du Sud (Tadorna cana)
-Tadorne radjah (Radjah radjah radjah)
-Ouette de Magellan (Chloephaga picta)
-Amazonette du Brésil (Amazonetta brasiliensis)
-Canard mandarin (Aix galericulata)
-Canard carolin (Aix sponsa)
-Bernache à crinière (Chenonetta jubata)
-Fuligule milouin (Aythya ferina)
-Fuligule morillon (Aythya marila)
-Fuligule milouinan (Aythya fuligula)
-Nette rousse (Netta rufina)
-Nette demi-deuil (Netta peposaca)
-Garrot d’Islande (Bucephala islandica)
-Garrot à oeil d’or (Bucephala clangula)
-Garrot albéole (Bucephala albeola)
-Eider à duvet (Somateria mollissima)
-Harle couronné (Lophodytes cucullatus)
-Harle piette (Mergellus albellus)
-Érismature rousse (Oxyura jamaicensis)
-Souchet d’Argentine (Spatula platalea)
-Sarcelle baïkal (Sibirionetta formosa) —> léger doute
-Canard du Cap (Anas capensis)
-Sarcelle chataîgne (Anas castanea)
-Sarcelle tachetée (Anas flavirostris) —> léger doute
-Canard de Chiloe (Mareca sibilatrix)
-Sarcelle canelle (Spatula cyanoptera)
-Sarcelle d’hiver (Anas crecca) —> léger doute
-Canard siffleur (Mareca penelope)
-Sarcelles à faucilles (Mareca falcata)
-Canard chipeau (Mareca strepera strepera)
-Pilet des bahamas (Anas bahamensis)
-Canard à bec tacheté (Anas poecilorhyncha poecilorhyncha)
-Canard de Laysan (Anas laysanensis) —> léger doute
-Canard de Meller (Anas melleri)
-Souchet de Nouvelle-Zélande (Spatula rhynchotis)
-Pilet d’Europe (Anas acuta)
-Souchet d’Europe (Spatula clypeata)
-Canard huppé de Patagonie (Lophonetta specularioides)
-Canard des Phillipines (Anas luzonica)
-Canard à bec jaune (Anas undulata)
Galliformes:
-Paon bleu (Pavo cristatus)
-Pintade vulturine (Acryllium vulturinum)
-Grand hocco (Crax rubra)
-Hocco à pierre (Pauxi pauxi)
-Rouloul couronné (Rollulus rouloul)
-Tragopan de Cabot (Tragopan caboti)
-Tragopan satyre (Tragopan satyra)
-Tragopan de Temminck (Tragopan temmicnkii)
-Faisan d’Edwards (Lophura edwardsi)
-Lophophore resplendissant (Lophophorus impejanus)
-Hokki blanc du Tibet (Crossoptilon crossoptilon drouynii)
-Éperonnier napoléon (Polyplectron napolensis)
-Dindon ocellé (Melagris ocellata)
-Perdrix des bambous (Bambusicola thoracica)
Probablement en coulisse:
-Faisan de Vieillot (Lophura ignita rufa)
-Coq bankiva (Gallus gallus)
-Coq de Lafayette (Gallus
-Faisan du Vietnam (Lophura hatinhensis), mais cela serait probablement une forme dégénérée du faisain d’Edwards du à la consanguinité
Gruiformes:
-Cariama huppé (Cariam cristata)
-Grue couronnée noire (Balearica pavonina)
-Grue couronnée grise (Balearica regulorum) —> un doute
-Grue du Japon (Grus japonensis)
-Grue de Paradis (Anthropoides paradisea)
-Grue demoiselle (Anthropoides virgo)
-Agami trompette (Psophia crepitans)
Charadriiformes:
-Vanneau soldat (Vanellus miles)
-Huitrier pie (Haematopus ostralegus)
-Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus oedicnemus)
-Échasse blanche (Himantopus himantopus)
-Avocette élégante (Recurvirostra avosetta)
Colombiformes:
-Goura de Sclater (Goura scheepmakeri sclateri)
-Tourtelette demoiselle (Turtur brehmeri)
-Colombe lophote (Ocyphaps lophotes)
-Colombe turvert (Chalcophaps indica)
-Gallicolombe poignardée (Gallicolumba luzonica)
-Gallicolombe de Bartlett (Gallicolumba crinigera)
-Pigeon nicobar (Caloenas nicobarica)
Psittaciformes:
-Ara ararauna (Ara ararauna)
-Ara macao (Ara macao)
-Perruche souris (Myopsitta monachus)
-Cacatoès blanc (Cacatua alba)
-Amazone à nuque d’or (Amazona auropalliata auropalliata)
-Amazone à joues vertes (Amazona viridigenalis)
-Amazone à front bleue (Amazona aestiva)
-Cacatoès à huppe jaune (Cacatua galerita galerita)
Musophagiformes:
-Touraco de Livingstone (Tauraco livingstonii)
-Touraco de Fischer (Tauraco fischeri)
-Touraco de Hartlaub (Tauraco hartlaubi) —> pas en présentation, peut-être en coulisse
-Touraco à huppe splendide (Gallirex porphyreolophus)
-Touraco à huppe blanche (Tauraco leucolophus)
-Touraco à joues blanches (Tauraco leucotis)
-Musophage violet (Musophaga violacea)
Strigiformes:
-Chouette lapone
Coraciiformes:
-Rollier à ventre bleu (Coracias cyanogaster)
-Rollier à longs brins (Coracias caudatus)
-Kookaburra (Dacelo novaeguineae)
Bucerotiformes:
-Huppe fascié (Upupa epops)
-Calao de Von der Decken (Tockus deckeni)
-Bucorve du Sud (Bucorvus leadbeateri)
Passeriformes:
-Spréo superbe (Lamprotornis superbus)
-Martin de Rothschild (Leucopsar rothscildi)
-Merle métallique vert (Lamprotornis chalybaeus)
-Merle métallique pourpre (Lamprotornis purpureus)
-Étourneau des pagodes (Sturnia pagodarum)
-Rouge gorge (Erithacus rubecula)
-Foudi de Madagascar (Foudia madagascriensis) —> non vu
-Travailleur à bec rouge (Quelea quelea))
-Tisserin gendarme (Ploceus cucullatus)
-Pyrolle à bec rouge (Urocissa erythroryncha)
Mammifères:
-Hydropote de Chine (Hydropotes inermis)
-Muntjac de Chine (Muntiacus reevesi)
-Antilope cervicapre (Antilope cervicapra)
-Gibbon à favoris roux (Nomascus gabriellae) —> un couple+ 2 jeunes
-Gibbon à favoris blanc (Nomascus leucogenys) —> un couple + un jeune
-Ouistiti pygmée (Cebuella pygmaea)
-Tamarin empereur (Saguinus imperator)
-Maki catta (Lemur catta)
-Happalémur du Lac Alaotra (hapalemur alaotrensis)
-Panda roux (Ailurus fulgens)
-Wallaby de bennett (Macropus rufogriseus)
Oiseaux:
Ratites:
-Émeu (Dromaius novaehollandiae)
Pelecaniformes:
-Pélican frisé (Pelecanus crispus)
-Ibis sacré (Threskiornis aethiopicus)
-Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax)
-Aigrette garzette (Egretta garzetta)
-Ibis chauve (Geronticus eremita)
-Ibis rouge (Eudocimus ruber)
-Spatule blanche (Platalea leucorodia)
-Saptule rose (Ajaja ajaja)
-Cigogne blanche (Ciconia ciconia ciconia)
Phoenicopteriformes:
-Flamant du Chili (Phoenicopterus chilensis)
Ansériformes:
-Kamichi à collier (Chaune torquata)
-Canaroie semi-palmée (Anseranas semipalmata)
-Dendrocygne des antilles (Dendrocygna arborea)
-Dendrocygne veuf (Dendrocygna viduata)
-Oie céréopse (Cereopsis novaeholladiae novaehollandiae)
-Oie à tête barrée (Anser indicus)
-Bernache nonette (Branta leucopsis)
-Bernache cravant (Branta bernicla)
-Oie empereur (Anser canagicus)
-Oie rieuse (Anser albifrons)
-Bernache de Hutchins (Branta hutchinsii minima)
-Grande bernache du Canada (Branta canadensis maxima)
-Bernache néné (branta sandvicensis)
-Oie des neiges (Anser caerulescens)
-Oie naine (Anser erythropus)
-Bernache à cou roux (Branta ruficollis)
-Oie de Ross (Anser rossii)
-Cygne noir (Cygnus atratus)
-Cygne à col noir (Cygnus melancoryphus)
-Tadorne d’Australie (Tadorna tadornaides)
-Tadorne casarca (Tadorna tadorna
-Tadorne de Belon (Tadorna ferruginea)
-Tadorne d’Afrique du Sud (Tadorna cana)
-Tadorne radjah (Radjah radjah radjah)
-Ouette de Magellan (Chloephaga picta)
-Amazonette du Brésil (Amazonetta brasiliensis)
-Canard mandarin (Aix galericulata)
-Canard carolin (Aix sponsa)
-Bernache à crinière (Chenonetta jubata)
-Fuligule milouin (Aythya ferina)
-Fuligule morillon (Aythya marila)
-Fuligule milouinan (Aythya fuligula)
-Nette rousse (Netta rufina)
-Nette demi-deuil (Netta peposaca)
-Garrot d’Islande (Bucephala islandica)
-Garrot à oeil d’or (Bucephala clangula)
-Garrot albéole (Bucephala albeola)
-Eider à duvet (Somateria mollissima)
-Harle couronné (Lophodytes cucullatus)
-Harle piette (Mergellus albellus)
-Érismature rousse (Oxyura jamaicensis)
-Souchet d’Argentine (Spatula platalea)
-Sarcelle baïkal (Sibirionetta formosa) —> léger doute
-Canard du Cap (Anas capensis)
-Sarcelle chataîgne (Anas castanea)
-Sarcelle tachetée (Anas flavirostris) —> léger doute
-Canard de Chiloe (Mareca sibilatrix)
-Sarcelle canelle (Spatula cyanoptera)
-Sarcelle d’hiver (Anas crecca) —> léger doute
-Canard siffleur (Mareca penelope)
-Sarcelles à faucilles (Mareca falcata)
-Canard chipeau (Mareca strepera strepera)
-Pilet des bahamas (Anas bahamensis)
-Canard à bec tacheté (Anas poecilorhyncha poecilorhyncha)
-Canard de Laysan (Anas laysanensis) —> léger doute
-Canard de Meller (Anas melleri)
-Souchet de Nouvelle-Zélande (Spatula rhynchotis)
-Pilet d’Europe (Anas acuta)
-Souchet d’Europe (Spatula clypeata)
-Canard huppé de Patagonie (Lophonetta specularioides)
-Canard des Phillipines (Anas luzonica)
-Canard à bec jaune (Anas undulata)
Galliformes:
-Paon bleu (Pavo cristatus)
-Pintade vulturine (Acryllium vulturinum)
-Grand hocco (Crax rubra)
-Hocco à pierre (Pauxi pauxi)
-Rouloul couronné (Rollulus rouloul)
-Tragopan de Cabot (Tragopan caboti)
-Tragopan satyre (Tragopan satyra)
-Tragopan de Temminck (Tragopan temmicnkii)
-Faisan d’Edwards (Lophura edwardsi)
-Lophophore resplendissant (Lophophorus impejanus)
-Hokki blanc du Tibet (Crossoptilon crossoptilon drouynii)
-Éperonnier napoléon (Polyplectron napolensis)
-Dindon ocellé (Melagris ocellata)
-Perdrix des bambous (Bambusicola thoracica)
Probablement en coulisse:
-Faisan de Vieillot (Lophura ignita rufa)
-Coq bankiva (Gallus gallus)
-Coq de Lafayette (Gallus
-Faisan du Vietnam (Lophura hatinhensis), mais cela serait probablement une forme dégénérée du faisain d’Edwards du à la consanguinité
Gruiformes:
-Cariama huppé (Cariam cristata)
-Grue couronnée noire (Balearica pavonina)
-Grue couronnée grise (Balearica regulorum) —> un doute
-Grue du Japon (Grus japonensis)
-Grue de Paradis (Anthropoides paradisea)
-Grue demoiselle (Anthropoides virgo)
-Agami trompette (Psophia crepitans)
Charadriiformes:
-Vanneau soldat (Vanellus miles)
-Huitrier pie (Haematopus ostralegus)
-Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus oedicnemus)
-Échasse blanche (Himantopus himantopus)
-Avocette élégante (Recurvirostra avosetta)
Colombiformes:
-Goura de Sclater (Goura scheepmakeri sclateri)
-Tourtelette demoiselle (Turtur brehmeri)
-Colombe lophote (Ocyphaps lophotes)
-Colombe turvert (Chalcophaps indica)
-Gallicolombe poignardée (Gallicolumba luzonica)
-Gallicolombe de Bartlett (Gallicolumba crinigera)
-Pigeon nicobar (Caloenas nicobarica)
Psittaciformes:
-Ara ararauna (Ara ararauna)
-Ara macao (Ara macao)
-Perruche souris (Myopsitta monachus)
-Cacatoès blanc (Cacatua alba)
-Amazone à nuque d’or (Amazona auropalliata auropalliata)
-Amazone à joues vertes (Amazona viridigenalis)
-Amazone à front bleue (Amazona aestiva)
-Cacatoès à huppe jaune (Cacatua galerita galerita)
Musophagiformes:
-Touraco de Livingstone (Tauraco livingstonii)
-Touraco de Fischer (Tauraco fischeri)
-Touraco de Hartlaub (Tauraco hartlaubi) —> pas en présentation, peut-être en coulisse
-Touraco à huppe splendide (Gallirex porphyreolophus)
-Touraco à huppe blanche (Tauraco leucolophus)
-Touraco à joues blanches (Tauraco leucotis)
-Musophage violet (Musophaga violacea)
Strigiformes:
-Chouette lapone
Coraciiformes:
-Rollier à ventre bleu (Coracias cyanogaster)
-Rollier à longs brins (Coracias caudatus)
-Kookaburra (Dacelo novaeguineae)
Bucerotiformes:
-Huppe fascié (Upupa epops)
-Calao de Von der Decken (Tockus deckeni)
-Bucorve du Sud (Bucorvus leadbeateri)
Passeriformes:
-Spréo superbe (Lamprotornis superbus)
-Martin de Rothschild (Leucopsar rothscildi)
-Merle métallique vert (Lamprotornis chalybaeus)
-Merle métallique pourpre (Lamprotornis purpureus)
-Étourneau des pagodes (Sturnia pagodarum)
-Rouge gorge (Erithacus rubecula)
-Foudi de Madagascar (Foudia madagascriensis) —> non vu
-Travailleur à bec rouge (Quelea quelea))
-Tisserin gendarme (Ploceus cucullatus)
-Pyrolle à bec rouge (Urocissa erythroryncha)
- orycterope
- Messages: 332
- Enregistré le: Dimanche 02 Juillet 2017 22:17
Re: Parc zoologique de Clères
Merci beaucoup d'avoir dressé cette liste détaillée des espèces ! Il y a apparemment une collection impressionnante d'oiseaux, mais je suis étonné de la petite collection de calaos, oiseaux pourtant spectaculaires. Je ne connais pas ce parc mais j'aimerais y faire un tour prochainement.
« Les oiseaux ne descendent pas des dinosaures, ce sont des dinosaures à proprement parler. »
Guillaume Lecointre
Guillaume Lecointre
-

gibbon - Messages: 2667
- Enregistré le: Jeudi 10 Mai 2012 11:31
Re: Parc zoologique de Clères
Oui, c’est vrai que deux espèces de calaos, ce n’est pas énorme pour un parc ornithologique.
Cependant, je mettrais des photos des volières, et je pense que vous vous rendrez compte qu’il est difficile de mettre une grosse espèce de calao type rhinocéros/bicorne, le Von Der Decken est vraiment la taille maximum… d’autant qu’il dispose d’une des plus grandes volières.
Il y a quelques années, des calaos à bec noir étaient aussi présentés.
Cependant, ce n’est pas non plus le groupe le plus oublié: il n’y a notamment pas de toucans/araçaris (espèces assez emblématiques aussi), ni de rapaces diurnes! Des guepiers, râles, couas, ainsi que des passereaux me plairaient bien aussi.
Cependant, le département de la Seine-maritime, propriétaire du parc depuis son achat au MNHN (pour 1€, c’est pas ça qui permettra de rénover la fauverie! )(je crois que c’est assez récent, pourtant, j’ai trouvé sur le net que le département gérait le parc depuis 1989…), a investi pas mal de fonds ces dernières années pour rénover les volières et le chateau, et souhaite donc équilibrer les fonds.
)(je crois que c’est assez récent, pourtant, j’ai trouvé sur le net que le département gérait le parc depuis 1989…), a investi pas mal de fonds ces dernières années pour rénover les volières et le chateau, et souhaite donc équilibrer les fonds.
Pour cela, dans les prochaines années, on devrait plutôt voir arriver des mammifères, et la collection aviaire risque d’être un peu délaissé, même si j’espère me tromper…
On le voit déjà avec les arrivées des pandas roux, tamarins pinchés et ouistitis pygmée ces dernières années.
Cependant, je mettrais des photos des volières, et je pense que vous vous rendrez compte qu’il est difficile de mettre une grosse espèce de calao type rhinocéros/bicorne, le Von Der Decken est vraiment la taille maximum… d’autant qu’il dispose d’une des plus grandes volières.
Il y a quelques années, des calaos à bec noir étaient aussi présentés.
Cependant, ce n’est pas non plus le groupe le plus oublié: il n’y a notamment pas de toucans/araçaris (espèces assez emblématiques aussi), ni de rapaces diurnes! Des guepiers, râles, couas, ainsi que des passereaux me plairaient bien aussi.
Cependant, le département de la Seine-maritime, propriétaire du parc depuis son achat au MNHN (pour 1€, c’est pas ça qui permettra de rénover la fauverie!
Pour cela, dans les prochaines années, on devrait plutôt voir arriver des mammifères, et la collection aviaire risque d’être un peu délaissé, même si j’espère me tromper…
On le voit déjà avec les arrivées des pandas roux, tamarins pinchés et ouistitis pygmée ces dernières années.
- orycterope
- Messages: 332
- Enregistré le: Dimanche 02 Juillet 2017 22:17
Re: Parc zoologique de Clères
Le parc animalier et botanique de Clères est né en 1919 (bientôt 100 ans), lorsque le jeune ornithologiste Jean Delacour rachète le domaine et le château de Clères. Jean Delacour possèdera le parc jusqu’en 1966, date à laquelle il le cède au MNHN, et le gèrera jusqu’en 1978.
La collection de Clères dépendit donc de ses nombreux voyages ornithologiques, durant lequel il complète les collections de Londres et de Paris, en envoyant 30 000 oiseaux, et 8000 mammifères… Une autre époque…
Il ramène aussi de ses voyages des oiseaux vivants, pour compléter son parc. C’est pour cela que la collection du parc fut fortement accès sur l’Indochine (où il fit énormément de voyage, comme c’était une province française), et sur Madagascar…
Cet héritage se ressent encore aujourd’hui, dans la collection du parc encore majoritairement accès sur les anatidés et les phasiannidés, ainsi que sur les espèces asiatiques.
Le parc, au fil de son histoire, a donc dû abriter probablement au moins un bon millier d’espèces, des colibris au paradisiers, en passant par les takahes, kagous, même si la spécialité du parc était bien sur les gallinacés, et les anatidés, et réussi pas mal première mondiale en terme de reproduction.
A son apogée, le parc abritait 3000 oiseaux appartenant à 500 espèces.
Pour en savoir plus sur la riche histoire du parc (détruit pendant la seconde guerre mondiale) et celle de son fondateur, qui a aussi participé à la fondation de l’actuelle AFDPZ, et de la LPO, son livre "Mémoires d’un ornithologiste" est très bien écrit, et regorge d’anecdotes et de récits de voyages passionnants.
Aujourd’hui, la collection reste importante, avec environ 1300 animaux appartenant à 150 espèces, dont 11 de mammifères, répartie sur 13 hectares (même si le parc en possède 53, notamment de l’autre côté de la route, où l’on peut voir un beau troupeau de cerf axis, et de mouton de Soay).
Depuis 2012, le parc est la propriété du département, qui a pas mal investi pour rénover le château, ainsi que l’intégralité ou presque des structures et des bâtiments des volières. Je pense que le passage du MNHN au département a du faire exploser le budget de fonctionnement du parc…
J’ai donc visité le parc dans la matinée du 1er Octobre. Ce n’est cependant pas ma première visite, et j’ai utilisé des photos d’autre visite pour compléter mon compte rendu, lorsque cela était nécessaire.
Après avoir acheté son billet dans la seule caisse, on se dirige sur la gauche, pour visiter la partie semi-liberté du parc.
Avec 95 000 visiteurs par an, et des pics à 2500 lors des grosses journées, autant dire que avec une seule caisse, c’est parfois le bazar…
Heureusement, la création d’un nouveau bâtiment d’accueil est en projet, et le budget (1 900 000€) a été voté l’année dernière. Cependant, je n’ai toujours pas vu de travaux à l’emplacement prévu depuis cette date…
Après avoir longé sur 200 mètres la prairie/pelouse devant le chateau, le visiteur arrive devant un bras de la Clèrette, la rivière locale, qui abrite les premiers anatidés. Ceux-ci sont donc "séparés" de la grande zone en semi-liberté du parc, mais dispose tout de même d’un beau bras de rivière, et de la prairie devant le château.
Voici donc la liste des espèces vivant ici, toute éjointés donc: Ibis sacré (Threskiornis aethiopicus), canaroie semi-palmée (Anseranas semipalmata), dendrocygne des antilles (Dendrocygna arborea), bernache cravant (Branta bernicla), oie de Ross (Anser rossii), bernache à cou roux (Branta ruficollis), cygne noir (Cygnus atratus), tadorne radjah (Radjah radjah radjah), amazonette du Brésil (Amazonetta brasiliensis), bernache à crinière (Chenonetta jubata), fuligule milouinan (Aythya fuligula), garrot d’Islande (Bucephala islandica), souchet d’Argentine (Spatula platalea), canard du Cap (Anas capensis), oie naine (Anser erythropus), tadorne casarca (Tadorna tadorna), canard de Chiloe (Mareca sibilatrix), canard de Laysan (Anas laysanensis), grue de Paradis (Anthropoides paradisea).




Prairie devant le château


Le bras de rivière

Canaroie semi-palmée


Harle piette

Tadorne casarca
Après avoir longé le bras de rivière, le visiteur fait demi-tour, traverse un petit pont, et pénètre par un petit portail dans l’autre partie du parc, où sont toutes les autres espèces en semi-liberté.
Avant d’arriver au grand étang, on longe un autre bras de la Clèrette, cloisonné afin de servir d’enclos à six autres espèces d’anatidés. La liste: Dendrocygne veuf (Dendrocygna viduata), garrot albéole (Bucephala albeola), sarcelle canelle (Spatula cyanoptera), canard à bec tacheté (Anas poecilorhyncha poecilorhyncha), le menacé canard de Meller (Anas melleri), et souchet de Nouvelle-Zélande (Spatula rhynchotis).


De l’autre côté du chemin se trouve une grande prairie, où viennent souvent les paons (Pavo cristatus), les grues couronnées grises (Balearica regulorum), les cigognes blanches (Ciconia ciconia), les bernaches nénés (Branta sandvicensis), ainsi que les kamichis (Chauna torquata).

C’est dans cette zone là aussi que je parviens parfois à observer l’hydropote (Hydropotes inermis) du parc. Ce ne fut pas le cas lors de cette visite, et bien que je l’ai vu au printemps, je ne sais pas s’il est encore là. En effet, les soigneurs du parc ne peuvent pas attraper facilement les hydropotes dans la zone de semi-liberté pour les vermifuger, et ils sont donc particulièrement sensibles aux maladies.

Photo un peu plus ancienne d’hydropote
Quelques wallabys de Bennett viennent aussi parfois brouter dans la zone, et les cervicapres peuvent aussi y descendre, bien que ce soit assez rare ces dernières années.
En effet, il y a quelques années, un troupeau de mâles cervicapres vivaient constamment sur cette partie du parc, repoussé par un mâle particulièrement violent et virulent. Le mâle dominant actuel, qui a pris sa place, en … le tuant, est plus tolérant, et laisse les mâles vivrent sur la partie haute du parc. Mais d’après un soigneur, sa domination pourrait prendre fin… C’est toute une histoire les cervicapres, et l’étude de leurs comportements doit être intéressant!
Le visiteur continue de progresser sur le chemin, et arrive près du grand étang. A sa gauche, un autre enclos le long de la Clèrette abrite des cygnes à col noir (Cygnus melancoryphus), des Tadornes d’Australie (Tadorna tadornaides), des canards mandarins (Aix galericulata), ainsi que des pilets des bahamas (Anas bahamensis).



A sa droite, un autre zone cloturée abrite souvent des jeunes canards, dont l’espèce varie donc, mais aussi des tadornes d’Afrique du Sud (Tadorna cana) et
dendrocygnes veuf (Dendrocygna viduata).

En continuant, le visiteur arrive devant l’enclos de pélicans frisés (Pelecanus crispus) du parc, eux aussi éjointés, et disposant d’un bout de Clèrette, avec une petite partie herbeuse.



En se retournant, le visiteur est devant le grand étang du parc. Celui-ci est en fait, encore une fois, un bras de la Clèrette (qui décidément fait tout), qui a été bloqué de manière à garder une hauteur d’eau constante, et un courant faible.
Cette étang à la faible profondeur est donc le lieu de vie de la majeur partie des anatidés du parc, ainsi que de la colonie de flamants du Chili (Phoenicopterus chilensis) du parc. Celle-ci ne se reproduit pas, notamment à cause de la présence des anatidés, mais le parc a récemment accueilli pas mal de jeunes de La Palmyre pour agrandir son groupe et ainsi tenter de les reproduire.








Outre ceux-ci, voici donc la liste de leurs colocataires anatidés, avec quelques espèces menacées (Fuligule milouin et canard des phillipines: Vulnérable).
Oie à tête barrée (Anser indicus), Bernache nonette (Branta leucopsis), Bernache de Hutchins (Branta hutchinsii minima), Grande bernache du Canada (Branta canadensis maxima), Bernache néné (branta sandvicensis), Oie des neiges (Anser caerulescens), oie rieuse (Anser albifrons), oie naine (Anser erythropus), tadorne de Belon (Tadorna ferruginea) fuligule milouin (Aythya ferina), fuligule morillon (Aythya marila), nette rousse (Netta rufina), nette demi-deuil (Netta peposaca), garrot à oeil d’or (Bucephala clangula), eider à duvet (Somateria mollissima), harle couronné (Lophodytes cucullatus), harle piette (Mergellus albellus), sarcelle baïkal (Sibirionetta formosa), sarcelle chataîgne (Anas castanea), sarcelle tachetée (Anas flavirostris), Canard siffleur (Mareca penelope), sarcelle à faucilles (Mareca falcata), canard chipeau (Mareca strepera strepera), pilet d’Europe (Anas acuta), souchet d’Europe (Spatula clypeata), canard huppé de Patagonie (Lophonetta specularioides), canard des Phillipines (Anas luzonica), canards carolins (Aix sponsa), et canard à bec jaune (Anas undulata).

Sarcelle tachetée (Anas flavirostris)

Fuligule milouin


Flamant du Chili

Oie des neiges
Tout ça déambule librement sur l’étang, ses berges, et la prairie à gauche et à droite de l’étang. Cependant, même les oies ne s’éloignent pas trop de l’étang, ne montant jamais dans la partie du parc.
Les effectifs sont assez conséquent, avec je pense au moins 200 canards dans cette zone. Cela se voit bien lorsque les anatidés sont nourris, tout le monde arrive en même temps, et on peut alors observer les différents modes d’alimentation (plongeurs, de surface, ou sur la terre ferme pour les oies).



Les cervicapres descendent aussi parfois, ici sur une photo de 2016
Sur cette étang se trouve aussi les îles de deux des espèces de primates du parc.
Un groupe de 4 mâles makis cattas disposent d’une île arborée de taille moyenne.


La famille de gibbons à favoris roux (Nomascus gabriellae) profite d’une autre île, plus grande, avec de hauts arbres, mais aussi avec une belle structure en cordage…



Une dernière île, derrière celle des gibbons sert de lieu de pontes aux canards, bien qu’ensuite les oeufs sont la plupart du temps récupérés, et les jeunes élevés en coulisse, dans la zone d’élevage du parc. En effet, il est difficile de laisser élever les canards en liberté, les goélands ayant fait une belle omelette cette année à priori…
Lorsque le visiteur regarde l’île des gibbons, il a dans son dos l’enclos des bucorves du Sud (Bucorvus leadbeateri).
C’est en fait une parcelle de prairie très en pente, avec quelques arbres sur le coté gauche.


En continuant sur le chemin, le visiteur arrive à une intersection: devant lui, il peut aller au chateau, dans lequel des expositions sont organisées (Plume(s) de l’oiseau à l’homme, tous les états de la plume), vitraux…)
Sinon, il tourne en épingle pour arriver sur la partie haute du parc.
Il peut donc observer dans celle-ci les antilopes cervicapres (Antilope cervicapra), les ouettes de Magellan (Chloephaga picta), la plupart des wallabys de Bennett (Macropus rufogriseus), un couple de grues de paradis (Anthropoides paradisea), et, s’il cherche bien, des lophophores resplendissants (Lophophorus impejanus).





Paon
Divers sentiers cheminent sur cette partie du parc, l’un d’eux permet de longer l’enclos des calaos par le haut. De l’autre côté du chemin, un petit enclos boisé abrite des muntjacs de Chine (Muntiacus reevesii).

La photo ne permet pas trop de se rendre compte de l’enclos, c’est un enclos très forestier, en longueur, et pas très grand.
A suivre…
La collection de Clères dépendit donc de ses nombreux voyages ornithologiques, durant lequel il complète les collections de Londres et de Paris, en envoyant 30 000 oiseaux, et 8000 mammifères… Une autre époque…
Il ramène aussi de ses voyages des oiseaux vivants, pour compléter son parc. C’est pour cela que la collection du parc fut fortement accès sur l’Indochine (où il fit énormément de voyage, comme c’était une province française), et sur Madagascar…
Cet héritage se ressent encore aujourd’hui, dans la collection du parc encore majoritairement accès sur les anatidés et les phasiannidés, ainsi que sur les espèces asiatiques.
Le parc, au fil de son histoire, a donc dû abriter probablement au moins un bon millier d’espèces, des colibris au paradisiers, en passant par les takahes, kagous, même si la spécialité du parc était bien sur les gallinacés, et les anatidés, et réussi pas mal première mondiale en terme de reproduction.
A son apogée, le parc abritait 3000 oiseaux appartenant à 500 espèces.
Pour en savoir plus sur la riche histoire du parc (détruit pendant la seconde guerre mondiale) et celle de son fondateur, qui a aussi participé à la fondation de l’actuelle AFDPZ, et de la LPO, son livre "Mémoires d’un ornithologiste" est très bien écrit, et regorge d’anecdotes et de récits de voyages passionnants.
Aujourd’hui, la collection reste importante, avec environ 1300 animaux appartenant à 150 espèces, dont 11 de mammifères, répartie sur 13 hectares (même si le parc en possède 53, notamment de l’autre côté de la route, où l’on peut voir un beau troupeau de cerf axis, et de mouton de Soay).
Depuis 2012, le parc est la propriété du département, qui a pas mal investi pour rénover le château, ainsi que l’intégralité ou presque des structures et des bâtiments des volières. Je pense que le passage du MNHN au département a du faire exploser le budget de fonctionnement du parc…
J’ai donc visité le parc dans la matinée du 1er Octobre. Ce n’est cependant pas ma première visite, et j’ai utilisé des photos d’autre visite pour compléter mon compte rendu, lorsque cela était nécessaire.
Après avoir acheté son billet dans la seule caisse, on se dirige sur la gauche, pour visiter la partie semi-liberté du parc.
Avec 95 000 visiteurs par an, et des pics à 2500 lors des grosses journées, autant dire que avec une seule caisse, c’est parfois le bazar…
Heureusement, la création d’un nouveau bâtiment d’accueil est en projet, et le budget (1 900 000€) a été voté l’année dernière. Cependant, je n’ai toujours pas vu de travaux à l’emplacement prévu depuis cette date…
Après avoir longé sur 200 mètres la prairie/pelouse devant le chateau, le visiteur arrive devant un bras de la Clèrette, la rivière locale, qui abrite les premiers anatidés. Ceux-ci sont donc "séparés" de la grande zone en semi-liberté du parc, mais dispose tout de même d’un beau bras de rivière, et de la prairie devant le château.
Voici donc la liste des espèces vivant ici, toute éjointés donc: Ibis sacré (Threskiornis aethiopicus), canaroie semi-palmée (Anseranas semipalmata), dendrocygne des antilles (Dendrocygna arborea), bernache cravant (Branta bernicla), oie de Ross (Anser rossii), bernache à cou roux (Branta ruficollis), cygne noir (Cygnus atratus), tadorne radjah (Radjah radjah radjah), amazonette du Brésil (Amazonetta brasiliensis), bernache à crinière (Chenonetta jubata), fuligule milouinan (Aythya fuligula), garrot d’Islande (Bucephala islandica), souchet d’Argentine (Spatula platalea), canard du Cap (Anas capensis), oie naine (Anser erythropus), tadorne casarca (Tadorna tadorna), canard de Chiloe (Mareca sibilatrix), canard de Laysan (Anas laysanensis), grue de Paradis (Anthropoides paradisea).




Prairie devant le château


Le bras de rivière

Canaroie semi-palmée


Harle piette

Tadorne casarca
Après avoir longé le bras de rivière, le visiteur fait demi-tour, traverse un petit pont, et pénètre par un petit portail dans l’autre partie du parc, où sont toutes les autres espèces en semi-liberté.
Avant d’arriver au grand étang, on longe un autre bras de la Clèrette, cloisonné afin de servir d’enclos à six autres espèces d’anatidés. La liste: Dendrocygne veuf (Dendrocygna viduata), garrot albéole (Bucephala albeola), sarcelle canelle (Spatula cyanoptera), canard à bec tacheté (Anas poecilorhyncha poecilorhyncha), le menacé canard de Meller (Anas melleri), et souchet de Nouvelle-Zélande (Spatula rhynchotis).


De l’autre côté du chemin se trouve une grande prairie, où viennent souvent les paons (Pavo cristatus), les grues couronnées grises (Balearica regulorum), les cigognes blanches (Ciconia ciconia), les bernaches nénés (Branta sandvicensis), ainsi que les kamichis (Chauna torquata).

C’est dans cette zone là aussi que je parviens parfois à observer l’hydropote (Hydropotes inermis) du parc. Ce ne fut pas le cas lors de cette visite, et bien que je l’ai vu au printemps, je ne sais pas s’il est encore là. En effet, les soigneurs du parc ne peuvent pas attraper facilement les hydropotes dans la zone de semi-liberté pour les vermifuger, et ils sont donc particulièrement sensibles aux maladies.

Photo un peu plus ancienne d’hydropote
Quelques wallabys de Bennett viennent aussi parfois brouter dans la zone, et les cervicapres peuvent aussi y descendre, bien que ce soit assez rare ces dernières années.
En effet, il y a quelques années, un troupeau de mâles cervicapres vivaient constamment sur cette partie du parc, repoussé par un mâle particulièrement violent et virulent. Le mâle dominant actuel, qui a pris sa place, en … le tuant, est plus tolérant, et laisse les mâles vivrent sur la partie haute du parc. Mais d’après un soigneur, sa domination pourrait prendre fin… C’est toute une histoire les cervicapres, et l’étude de leurs comportements doit être intéressant!
Le visiteur continue de progresser sur le chemin, et arrive près du grand étang. A sa gauche, un autre enclos le long de la Clèrette abrite des cygnes à col noir (Cygnus melancoryphus), des Tadornes d’Australie (Tadorna tadornaides), des canards mandarins (Aix galericulata), ainsi que des pilets des bahamas (Anas bahamensis).



A sa droite, un autre zone cloturée abrite souvent des jeunes canards, dont l’espèce varie donc, mais aussi des tadornes d’Afrique du Sud (Tadorna cana) et
dendrocygnes veuf (Dendrocygna viduata).

En continuant, le visiteur arrive devant l’enclos de pélicans frisés (Pelecanus crispus) du parc, eux aussi éjointés, et disposant d’un bout de Clèrette, avec une petite partie herbeuse.



En se retournant, le visiteur est devant le grand étang du parc. Celui-ci est en fait, encore une fois, un bras de la Clèrette (qui décidément fait tout), qui a été bloqué de manière à garder une hauteur d’eau constante, et un courant faible.
Cette étang à la faible profondeur est donc le lieu de vie de la majeur partie des anatidés du parc, ainsi que de la colonie de flamants du Chili (Phoenicopterus chilensis) du parc. Celle-ci ne se reproduit pas, notamment à cause de la présence des anatidés, mais le parc a récemment accueilli pas mal de jeunes de La Palmyre pour agrandir son groupe et ainsi tenter de les reproduire.








Outre ceux-ci, voici donc la liste de leurs colocataires anatidés, avec quelques espèces menacées (Fuligule milouin et canard des phillipines: Vulnérable).
Oie à tête barrée (Anser indicus), Bernache nonette (Branta leucopsis), Bernache de Hutchins (Branta hutchinsii minima), Grande bernache du Canada (Branta canadensis maxima), Bernache néné (branta sandvicensis), Oie des neiges (Anser caerulescens), oie rieuse (Anser albifrons), oie naine (Anser erythropus), tadorne de Belon (Tadorna ferruginea) fuligule milouin (Aythya ferina), fuligule morillon (Aythya marila), nette rousse (Netta rufina), nette demi-deuil (Netta peposaca), garrot à oeil d’or (Bucephala clangula), eider à duvet (Somateria mollissima), harle couronné (Lophodytes cucullatus), harle piette (Mergellus albellus), sarcelle baïkal (Sibirionetta formosa), sarcelle chataîgne (Anas castanea), sarcelle tachetée (Anas flavirostris), Canard siffleur (Mareca penelope), sarcelle à faucilles (Mareca falcata), canard chipeau (Mareca strepera strepera), pilet d’Europe (Anas acuta), souchet d’Europe (Spatula clypeata), canard huppé de Patagonie (Lophonetta specularioides), canard des Phillipines (Anas luzonica), canards carolins (Aix sponsa), et canard à bec jaune (Anas undulata).

Sarcelle tachetée (Anas flavirostris)

Fuligule milouin


Flamant du Chili

Oie des neiges
Tout ça déambule librement sur l’étang, ses berges, et la prairie à gauche et à droite de l’étang. Cependant, même les oies ne s’éloignent pas trop de l’étang, ne montant jamais dans la partie du parc.
Les effectifs sont assez conséquent, avec je pense au moins 200 canards dans cette zone. Cela se voit bien lorsque les anatidés sont nourris, tout le monde arrive en même temps, et on peut alors observer les différents modes d’alimentation (plongeurs, de surface, ou sur la terre ferme pour les oies).



Les cervicapres descendent aussi parfois, ici sur une photo de 2016
Sur cette étang se trouve aussi les îles de deux des espèces de primates du parc.
Un groupe de 4 mâles makis cattas disposent d’une île arborée de taille moyenne.


La famille de gibbons à favoris roux (Nomascus gabriellae) profite d’une autre île, plus grande, avec de hauts arbres, mais aussi avec une belle structure en cordage…



Une dernière île, derrière celle des gibbons sert de lieu de pontes aux canards, bien qu’ensuite les oeufs sont la plupart du temps récupérés, et les jeunes élevés en coulisse, dans la zone d’élevage du parc. En effet, il est difficile de laisser élever les canards en liberté, les goélands ayant fait une belle omelette cette année à priori…
Lorsque le visiteur regarde l’île des gibbons, il a dans son dos l’enclos des bucorves du Sud (Bucorvus leadbeateri).
C’est en fait une parcelle de prairie très en pente, avec quelques arbres sur le coté gauche.


En continuant sur le chemin, le visiteur arrive à une intersection: devant lui, il peut aller au chateau, dans lequel des expositions sont organisées (Plume(s) de l’oiseau à l’homme, tous les états de la plume), vitraux…)
Sinon, il tourne en épingle pour arriver sur la partie haute du parc.
Il peut donc observer dans celle-ci les antilopes cervicapres (Antilope cervicapra), les ouettes de Magellan (Chloephaga picta), la plupart des wallabys de Bennett (Macropus rufogriseus), un couple de grues de paradis (Anthropoides paradisea), et, s’il cherche bien, des lophophores resplendissants (Lophophorus impejanus).





Paon
Divers sentiers cheminent sur cette partie du parc, l’un d’eux permet de longer l’enclos des calaos par le haut. De l’autre côté du chemin, un petit enclos boisé abrite des muntjacs de Chine (Muntiacus reevesii).

La photo ne permet pas trop de se rendre compte de l’enclos, c’est un enclos très forestier, en longueur, et pas très grand.
A suivre…
- orycterope
- Messages: 332
- Enregistré le: Dimanche 02 Juillet 2017 22:17
Re: Parc zoologique de Clères
Merci pour ce très bon début de compte-rendu, riche en détails et avec de très belles photos ! Clères a vraiment l'air d'être un parc atypique. Le site naturel est superbe, le château est très beau, l'ensemble doit dégager un charme particulier. Pour l'instant, les animaux, mammifères et oiseaux, profitent de grandes étendues naturelles, mais la plupart des oiseaux sont éjointés, ce qui est quand même très gênant. Dommage, parce que de nombreuses espèces intéressantes sont présentées. Les cervidés bénéficient de conditions de vie qui semblent exceptionnelles.
- abel
- Messages: 3651
- Enregistré le: Lundi 02 Novembre 2015 18:47
- Localisation: Tours/Rennes
Re: Parc zoologique de Clères
On a donc désormais terminé la partie semi-liberté, bien que depuis les volières on peut parfois apercevoir un wallaby ou un lophophore se baladant.
On monte donc vers les volières, et on tourne à droite vers la première série de volières, les volières Jean Delacour.
Cette série de volière assez ancienne a été rénové cette année, avec notamment la création d’un batiment chauffé.
En face de cette série de volière se trouve une des nouveautés assez récente du parc: les pandas roux (Ailurus fulgens).
Les deux mâles disposent de pas mal de structures en bois mort, assez haute, et d’un enclos bien végétalisé, bien que celui-ci n’ait rien d’exceptionnel.

Place maintenant aux volières. La cohérence géographique est absente de toutes les volières du parc. Celle-ci sont la plupart du temps très bien végétalisée, et esthétique grâce au travail des nombreux paysagistes/jardiniers du parc. Cependant, bon nombre manque un peu de hauteur, et sont parfois petites pour les espèces qu’elles accueillent.

La première volière de la série, à gauche, abrite deux agamis trompettes (Psophia crepitans), une spatule rose (Ajaja ajaja), des touracos de Livingstone (Tauraco livingstonii), et une huppe fascié (Upupa epops).

Celle à sa droite à récupéré ses occupants historiques (en tout cas depuis que je visite le parc) après les rénovations, à savoir un groupe d’ibis rouge (Eudocimus ruber).

Plus à droite une volière de même taille abrite bon nombre d’espèces. C’est en effet le lieu de vie de spréo superbe (Lamprotornis superbus), de pintades vulturines (Acryllium vulturinum), de vanneaux soldats (Vanellus miles), de rolliers à ventre bleu (Coracias cyanogaster), et d’une importante colonie de travailleurs à bec rouge (Quelea quelea).


La belle colonie de Quelea, dont on ne voit pas tous les membres sur la photo

Rollier à ventre bleu
La volière à droite est bien plus grande, mais tout en longueur. Elle abrite des gouras de Sclater (Goura scheepmakeri sclateri), qui se reproduisent fréquemment et doivent donc désormais être 6 dans cette volière, un autre vanneau soldat (Vanellus miles), un autre spréo superbe (Lamprotornis superbus), un tisserin gendarme (Ploceus cucullatus), le couple de calaos de Von der Decken (Tockus deckeni), des tourtelettes demoiselles (Turtur brehmeri) et des colombes lophotes (Ocyphaps lophotes).
Je n’ai pas vu les foudis de Madagascar (Foudia madagascriensis), qui normalement sont dans cette volière.


Vanneau soldat

Tourtelette demoiselle
En face de cette volière se trouve un enclos pour des grues du Japon (Grus japonensis), disposant de végétation sur les côtés et d’un petit bassin.

On traverse ensuite la seule volière de contact du parc: celle-ci héberge un groupe reproducteur d’ibis chauve (Geronticus eremita), des aigrettes garzettes (Egretta garzetta), des bihoreaux gris (Nycticorax nycticorax), ainsi qu’un bon nombre d’huitrier-pie (Haematopus haematopus) qui anime le sol.

Après être sortie de la volière, on tourne à gauche. Un chemin sur la droite mène à la zone d’élevage du parc, non visitable.
On se retrouve donc devant une nouvelle série de volières sur la droite.
Sur la gauche, c’est un groupe des très menacés hapalémurs du Lac Alaotra (Hapalemur alaotrensis) qui profite d’une volière en longueur. Le groupe s’est bien reproduit depuis son arrivée en 2008, (notamment des jumeaux en 2013), mais je n’ai pas vu de jeunes depuis quelques temps, et les hapalémurs ne sont pas sortis lors de ma visite.
Ceux-ci sont liés à l’histoire du parc, puisque Jean Delacour les a observé lors de son voyage à Madagascar en 1929.
En face de cette volière se trouve donc une série de 6 volières. Celle-ci font toutes la même taille, sauf la plus à droite, plus grande, qui est en fait la réunion de deux volières.
Les volières sont donc toutes assez semblables, disposant de pas mal de végétation, mais pas forcément très haute ni large.
La volière la plus à droite abrite des hoccos à pierre (Pauxi pauxi), et des touracos de Fischer (Tauraco fischeri).


Hocco à pierre
Ensuite, on trouve des rolliers à longs brins (Coracias caudatus) avec des gallicolombes poignardées (Gallicolumba luzonica) et des tourtelettes demoiselles (Turtur brehmeri), puis des merles métalliques pourpres (Lamprotornis purpureus) avec des roulouls couronnées (Rollulus rouloul) et des musophages violets (Musophaga violacea).


Rollier à longs brins

Merle métallique vert
Les trois dernières volières abritent des touracos à joues blanches (Tauraco leucotis) avec des étourneaux des pagodes (Sturnia pagodarum), des gallicolombes de Bartlett (Gallicolumba crinigera) avec des étourneaux de Bali (Leucopsar rothscildi), et encore une fois des roulouls couronnées (Rollulus rouloul), cette fois-ci avec des merles métalliques verts (Lamprotornis chalybaeus).

Touraco à joues blanches

Colombe de Bartlett


Volière type

Vue en ressortant, avec les volières à gauche, on devine la volière des hapalémurs à droite
On ressort alors de cette allée de volière pour reprendre le chemin qui monte vers deux autres séries de volières.
En arrivant au bout de ce chemin, on tombe d’abord sur l’enclos des oies céréopses (Cereopsis novaeholladiae novaehollandiae)
A droite et à gauche se trouve deux blocs de volière.
On se dirige d’abord vers celle de droite.
En descendant vers ce bloc, on observe sur notre gauche des grues couronnées noires (Balearica pavonina), la cinquième et dernière espèce de gruidés du parc.

Arrivé en bas, une volière rectangulaire et assez grande se dresse devant nous. Elle a pour thématique la baie de Somme, et héberge donc des oedicnèmes criards (Burhinus oedicnemus oedicnemus), des avocettes élégantes (Recurvirostra avosetta), des échasses blanches Himantopus himantopus) et des spatules blanches (Platalea leucorodia). Il y avait aussi jusqu’à peu des sarcelles d’hiver (Anas crecca) dans cette volière.



Échasse blanche

Spatule blanche
De l’autre côté d’un petite place, une série de 5 volières présente majoritairement des touracos et des phasiannidés. La configuration de ces volières est semblable à celle vu précédemment, avec lesquelles elles partagent le même batiment.
On retrouve ici des touracos à huppe splendide (Gallirex porphyreolophus), puis des colombes turverts (Chalcophaps indica), avec des tragopans de Cabot (Tragopan caboti), des faisans d’Edwards (Lophura edwardsi) avec des touracos à huppe blanche (Tauraco leucolophus), des tragopans de Temminck (Tragopan temmicnkii), encore une fois avec des colombes turverts (Chalcophaps indica), et enfin, des hoccos à pierre (Pauxi pauxi), avec une pyrolle à bec rouge (Urocissa erythroryncha), et … un rouge-gorge (Erithacus rubecula).





Colombe turvert
Après être repassé devant l’enclos des grues, puis devant celui des céréopses, on parvient devant un autre bloc de volière.
10 volières sont organisés autour d’un batiment central. En fait, il n’y a que 9 volières, puisque celle des tamarins réunit deux volières.
Les volières sont toutes des carrés, de 4m par 4m je pense, et assez basse (un peu plus de 2m de haut).
En commençant par l’allée de droite, on observe d’abord les kookaburras (Dacelo novaeguineae).
A droite de cette allée de volière se trouve un enclos forestier où vivent des émeus, pas vraiment mise en valeur (Dromaius novaehollandiae). Des casoars seraient plus adaptés à cet enclos.
La volière suivante héberge un couple de lophophore resplendissant (Lophophorus impejanus). Je me demande quelles sont les meilleures conditions de vie pour ces animaux? Éjointés dans une dizaine d’hectare, ou non éjointés, mais dans une volière où ils ne peuvent pas voler…
En tout cas, je ne pense pas qu’ils soient nécessaire de les garder dans cette volière, ce qui libèrerait une place pour d’autres espèces (bien que d’autres places puissent être trouvés ailleurs, il y a en effet quelques doublons d’espèces).
La volière suivante abrite la troisième espèce de tragopan du parc, les tragopans satyres (Tragopan satyra), en cohabitation avec des pyrolles à bec rouge (Urocissa erythrorhyncha) (qui doivent être les parents de l’autre).
Outre ces trois espèces de tragopans, le parc a aussi eux le dernier mâle tragopan de Blyth d’Europe il y a quelques années (en tout cas pour les zoos, peut-être y en a t’il en élevage?).
Les deux volières suivantes présentent elles aussi des phasiannidés, respectivement un couple de hokkis blancs (Crossoptilon crossoptilon drouynii), et un couple d’Éperonnier napoléon (Polyplectron napolensis).

On peut alors observer la plaine où passent la plupart du temps les cervicapres, en arrivant au bout de l’allée.

L’autre côté du bloc de volière commence par une volière pour étourneaux de Bali (Leucopsar rothscildi) et dindon ocellé (Melagris ocellata).

La volière suivante abrite l’autre hocco du parc, à savoir le grand hocco (Crax rubra).
Nous voici maintenant devant la volière des tamarins empereurs (Saguinus imperator). Ceux-ci disposent d’une volière deux fois plus large, mais un peu moins profonde, en raison du garde corps. Une cohabitation avec une espèce au sol pourrait être intéressante.

Un couple avec deux jeunes vit ici. Ces derniers étaient très curieux, nous suivant le long du grillage, et approchant leur petite tête près de l’objectif de l’appareil photo.



La dernière volière est consacré à des cariamas huppés (Cariama cristata).

Un couple de cette espèce coureuse vivait dans un enclos, actuellement non utilisé, le long de l’enclos des calaos à cette époque.
Cette enclos, très en pente, avec des herbes hautes, étaient assez grand. Là encore, je me demande ce qui est le mieux pour cette espèce: éjointés dans un bel enclos, ou volant dans une petite volière?
Bien sûr, la combinaison des deux serait l’idéal…
On retourne donc sur le chemin qui longe les volières. Après être repassé devant la porte qui mène aux hapalémurs, on tourne sur notre gauche vers la dernière série de volière.
Celle-ci débute d’abord par la volière des chouettes lapones (Strix nebulosa), seul rapace du parc. Celle-ci dispose d’une volière bien végétalisée, de taille moyenne. J’y verrais mieux une espèce plus petite, et plus active. En effet, en de nombreuses visites, je n’ai jamais vu le couple actif.

On arrive alors devant la rangée de volières proprement dite. La rangée de droite est une rangée de petites volières, basses de plafond, toute petite, et sombre, qui abrite la majorité des psittacidés du parc.
Celle-ci n’ont pas été rénovés, contrairement aux volières de gauche. Dommage qu’elles n’aient pas été englobé aux volières de gauche lors de la rénovation.
Ces volières abritent des perruches souris (Myopsitta monachus), des perdrix des bambous (Bambusicola thoracica), des aras macaos (Ara macao), un cacatoès blanc (Cacatua alba), des cacatoès à huppe jaune (Cacatua galerita) une amazone à front bleu (Amazona aestiva), une amazone à nuque d’or (Amazona auropalliata auropalliata), des amazones à joues vertes (Amazona viridigenalis), ainsi que dans la dernière volière, deux minuscules ouistitis pygmées (Cebuella pygmaea).

Volière type, c’est celle qui abrite les ouistitis pygmées maintenant.


Sur notre gauche, une volière présente des pigeons nicobars (Caloenas nicobarica), avec des roulouls couronnées (Rollulus rouloul).

Cette volière abritait avant la rénovation un rare (Vulnérable) pigeon du Pérou (Patagioenas oenops).
L’autre volière sur notre gauche est celle des spatules, agamis et huppes. On a donc fait le tour!
Pour terminer notre visite, on redescend pour aller observer les gibbons à favoris blancs (Nomascus leucogenys) dans leur volière datant de l’année dernière.
Celle-ci est grande et bien végétalisée, mais les conditions de vie de ces gibbons ne peuvent pas être comparées avec celles de ceux qui vivent sur l’île.



A droite de leur volière, une petite volière abrite des aras araraunas (Ara ararauna).

Voici comment s’achève notre visite du parc de Clères, bien que le visiteur puisse aller voir le chateau, ou les jardins se trouvant devant s’il le souhaite.
Le parc de Clères est un parc atypique, avec un cadre magnifique, et une partie principale qui offre des très bonnes conditions de vie à ses pensionnaires, si l’on exclue le fait que tous les oiseaux sont éjointés. Les volières offrent des conditions un peu moins bonne à la plupart des oiseaux.
J’ai trouvé que la collection, majoritairement axée sur les anatidés et les phasiannidés, s’était un peu appauvri ces dernières années, même s’il y a pas mal d’espèces menacées, et j’espère que maintenant que toute les volières sont rénovées, elle va pouvoir s’étoffer.
Je n’ai pas évoqué la pédagogie, mais les panneaux sont très sommaires, évoquant uniquement le nom de l’espèce et sa répartition la plupart du temps, et aucun panneaux ne permet d’identifier les anatidés du parc (il vaut mieux être un connaisseur!).
Cependant, le parc organise pas mal de journées thématique, avec des animations, et je crois qu’il est très impliqué au niveau des scolaires.
Voilà pour ce compte rendu du parc de Clères.
J’ai essayé d’être objectif, mais, comme je visite le parc trois/quatre fois par an, j’ai tendance à ne plus forcément voir les points noirs, et à être moins objectif. De plus, comme je vois tout le temps ces espèces là, je serais bien incapable de vous dire lesquelles sont rares en captivité, puisque j’ai l’impression de les voir tout le temps!
On monte donc vers les volières, et on tourne à droite vers la première série de volières, les volières Jean Delacour.
Cette série de volière assez ancienne a été rénové cette année, avec notamment la création d’un batiment chauffé.
En face de cette série de volière se trouve une des nouveautés assez récente du parc: les pandas roux (Ailurus fulgens).
Les deux mâles disposent de pas mal de structures en bois mort, assez haute, et d’un enclos bien végétalisé, bien que celui-ci n’ait rien d’exceptionnel.

Place maintenant aux volières. La cohérence géographique est absente de toutes les volières du parc. Celle-ci sont la plupart du temps très bien végétalisée, et esthétique grâce au travail des nombreux paysagistes/jardiniers du parc. Cependant, bon nombre manque un peu de hauteur, et sont parfois petites pour les espèces qu’elles accueillent.

La première volière de la série, à gauche, abrite deux agamis trompettes (Psophia crepitans), une spatule rose (Ajaja ajaja), des touracos de Livingstone (Tauraco livingstonii), et une huppe fascié (Upupa epops).

Celle à sa droite à récupéré ses occupants historiques (en tout cas depuis que je visite le parc) après les rénovations, à savoir un groupe d’ibis rouge (Eudocimus ruber).

Plus à droite une volière de même taille abrite bon nombre d’espèces. C’est en effet le lieu de vie de spréo superbe (Lamprotornis superbus), de pintades vulturines (Acryllium vulturinum), de vanneaux soldats (Vanellus miles), de rolliers à ventre bleu (Coracias cyanogaster), et d’une importante colonie de travailleurs à bec rouge (Quelea quelea).


La belle colonie de Quelea, dont on ne voit pas tous les membres sur la photo

Rollier à ventre bleu
La volière à droite est bien plus grande, mais tout en longueur. Elle abrite des gouras de Sclater (Goura scheepmakeri sclateri), qui se reproduisent fréquemment et doivent donc désormais être 6 dans cette volière, un autre vanneau soldat (Vanellus miles), un autre spréo superbe (Lamprotornis superbus), un tisserin gendarme (Ploceus cucullatus), le couple de calaos de Von der Decken (Tockus deckeni), des tourtelettes demoiselles (Turtur brehmeri) et des colombes lophotes (Ocyphaps lophotes).
Je n’ai pas vu les foudis de Madagascar (Foudia madagascriensis), qui normalement sont dans cette volière.


Vanneau soldat

Tourtelette demoiselle
En face de cette volière se trouve un enclos pour des grues du Japon (Grus japonensis), disposant de végétation sur les côtés et d’un petit bassin.

On traverse ensuite la seule volière de contact du parc: celle-ci héberge un groupe reproducteur d’ibis chauve (Geronticus eremita), des aigrettes garzettes (Egretta garzetta), des bihoreaux gris (Nycticorax nycticorax), ainsi qu’un bon nombre d’huitrier-pie (Haematopus haematopus) qui anime le sol.

Après être sortie de la volière, on tourne à gauche. Un chemin sur la droite mène à la zone d’élevage du parc, non visitable.
On se retrouve donc devant une nouvelle série de volières sur la droite.
Sur la gauche, c’est un groupe des très menacés hapalémurs du Lac Alaotra (Hapalemur alaotrensis) qui profite d’une volière en longueur. Le groupe s’est bien reproduit depuis son arrivée en 2008, (notamment des jumeaux en 2013), mais je n’ai pas vu de jeunes depuis quelques temps, et les hapalémurs ne sont pas sortis lors de ma visite.
Ceux-ci sont liés à l’histoire du parc, puisque Jean Delacour les a observé lors de son voyage à Madagascar en 1929.
En face de cette volière se trouve donc une série de 6 volières. Celle-ci font toutes la même taille, sauf la plus à droite, plus grande, qui est en fait la réunion de deux volières.
Les volières sont donc toutes assez semblables, disposant de pas mal de végétation, mais pas forcément très haute ni large.
La volière la plus à droite abrite des hoccos à pierre (Pauxi pauxi), et des touracos de Fischer (Tauraco fischeri).


Hocco à pierre
Ensuite, on trouve des rolliers à longs brins (Coracias caudatus) avec des gallicolombes poignardées (Gallicolumba luzonica) et des tourtelettes demoiselles (Turtur brehmeri), puis des merles métalliques pourpres (Lamprotornis purpureus) avec des roulouls couronnées (Rollulus rouloul) et des musophages violets (Musophaga violacea).


Rollier à longs brins

Merle métallique vert
Les trois dernières volières abritent des touracos à joues blanches (Tauraco leucotis) avec des étourneaux des pagodes (Sturnia pagodarum), des gallicolombes de Bartlett (Gallicolumba crinigera) avec des étourneaux de Bali (Leucopsar rothscildi), et encore une fois des roulouls couronnées (Rollulus rouloul), cette fois-ci avec des merles métalliques verts (Lamprotornis chalybaeus).

Touraco à joues blanches

Colombe de Bartlett


Volière type

Vue en ressortant, avec les volières à gauche, on devine la volière des hapalémurs à droite
On ressort alors de cette allée de volière pour reprendre le chemin qui monte vers deux autres séries de volières.
En arrivant au bout de ce chemin, on tombe d’abord sur l’enclos des oies céréopses (Cereopsis novaeholladiae novaehollandiae)
A droite et à gauche se trouve deux blocs de volière.
On se dirige d’abord vers celle de droite.
En descendant vers ce bloc, on observe sur notre gauche des grues couronnées noires (Balearica pavonina), la cinquième et dernière espèce de gruidés du parc.

Arrivé en bas, une volière rectangulaire et assez grande se dresse devant nous. Elle a pour thématique la baie de Somme, et héberge donc des oedicnèmes criards (Burhinus oedicnemus oedicnemus), des avocettes élégantes (Recurvirostra avosetta), des échasses blanches Himantopus himantopus) et des spatules blanches (Platalea leucorodia). Il y avait aussi jusqu’à peu des sarcelles d’hiver (Anas crecca) dans cette volière.



Échasse blanche

Spatule blanche
De l’autre côté d’un petite place, une série de 5 volières présente majoritairement des touracos et des phasiannidés. La configuration de ces volières est semblable à celle vu précédemment, avec lesquelles elles partagent le même batiment.
On retrouve ici des touracos à huppe splendide (Gallirex porphyreolophus), puis des colombes turverts (Chalcophaps indica), avec des tragopans de Cabot (Tragopan caboti), des faisans d’Edwards (Lophura edwardsi) avec des touracos à huppe blanche (Tauraco leucolophus), des tragopans de Temminck (Tragopan temmicnkii), encore une fois avec des colombes turverts (Chalcophaps indica), et enfin, des hoccos à pierre (Pauxi pauxi), avec une pyrolle à bec rouge (Urocissa erythroryncha), et … un rouge-gorge (Erithacus rubecula).





Colombe turvert
Après être repassé devant l’enclos des grues, puis devant celui des céréopses, on parvient devant un autre bloc de volière.
10 volières sont organisés autour d’un batiment central. En fait, il n’y a que 9 volières, puisque celle des tamarins réunit deux volières.
Les volières sont toutes des carrés, de 4m par 4m je pense, et assez basse (un peu plus de 2m de haut).
En commençant par l’allée de droite, on observe d’abord les kookaburras (Dacelo novaeguineae).
A droite de cette allée de volière se trouve un enclos forestier où vivent des émeus, pas vraiment mise en valeur (Dromaius novaehollandiae). Des casoars seraient plus adaptés à cet enclos.
La volière suivante héberge un couple de lophophore resplendissant (Lophophorus impejanus). Je me demande quelles sont les meilleures conditions de vie pour ces animaux? Éjointés dans une dizaine d’hectare, ou non éjointés, mais dans une volière où ils ne peuvent pas voler…
En tout cas, je ne pense pas qu’ils soient nécessaire de les garder dans cette volière, ce qui libèrerait une place pour d’autres espèces (bien que d’autres places puissent être trouvés ailleurs, il y a en effet quelques doublons d’espèces).
La volière suivante abrite la troisième espèce de tragopan du parc, les tragopans satyres (Tragopan satyra), en cohabitation avec des pyrolles à bec rouge (Urocissa erythrorhyncha) (qui doivent être les parents de l’autre).
Outre ces trois espèces de tragopans, le parc a aussi eux le dernier mâle tragopan de Blyth d’Europe il y a quelques années (en tout cas pour les zoos, peut-être y en a t’il en élevage?).
Les deux volières suivantes présentent elles aussi des phasiannidés, respectivement un couple de hokkis blancs (Crossoptilon crossoptilon drouynii), et un couple d’Éperonnier napoléon (Polyplectron napolensis).

On peut alors observer la plaine où passent la plupart du temps les cervicapres, en arrivant au bout de l’allée.

L’autre côté du bloc de volière commence par une volière pour étourneaux de Bali (Leucopsar rothscildi) et dindon ocellé (Melagris ocellata).

La volière suivante abrite l’autre hocco du parc, à savoir le grand hocco (Crax rubra).
Nous voici maintenant devant la volière des tamarins empereurs (Saguinus imperator). Ceux-ci disposent d’une volière deux fois plus large, mais un peu moins profonde, en raison du garde corps. Une cohabitation avec une espèce au sol pourrait être intéressante.

Un couple avec deux jeunes vit ici. Ces derniers étaient très curieux, nous suivant le long du grillage, et approchant leur petite tête près de l’objectif de l’appareil photo.



La dernière volière est consacré à des cariamas huppés (Cariama cristata).

Un couple de cette espèce coureuse vivait dans un enclos, actuellement non utilisé, le long de l’enclos des calaos à cette époque.
Cette enclos, très en pente, avec des herbes hautes, étaient assez grand. Là encore, je me demande ce qui est le mieux pour cette espèce: éjointés dans un bel enclos, ou volant dans une petite volière?
Bien sûr, la combinaison des deux serait l’idéal…
On retourne donc sur le chemin qui longe les volières. Après être repassé devant la porte qui mène aux hapalémurs, on tourne sur notre gauche vers la dernière série de volière.
Celle-ci débute d’abord par la volière des chouettes lapones (Strix nebulosa), seul rapace du parc. Celle-ci dispose d’une volière bien végétalisée, de taille moyenne. J’y verrais mieux une espèce plus petite, et plus active. En effet, en de nombreuses visites, je n’ai jamais vu le couple actif.

On arrive alors devant la rangée de volières proprement dite. La rangée de droite est une rangée de petites volières, basses de plafond, toute petite, et sombre, qui abrite la majorité des psittacidés du parc.
Celle-ci n’ont pas été rénovés, contrairement aux volières de gauche. Dommage qu’elles n’aient pas été englobé aux volières de gauche lors de la rénovation.
Ces volières abritent des perruches souris (Myopsitta monachus), des perdrix des bambous (Bambusicola thoracica), des aras macaos (Ara macao), un cacatoès blanc (Cacatua alba), des cacatoès à huppe jaune (Cacatua galerita) une amazone à front bleu (Amazona aestiva), une amazone à nuque d’or (Amazona auropalliata auropalliata), des amazones à joues vertes (Amazona viridigenalis), ainsi que dans la dernière volière, deux minuscules ouistitis pygmées (Cebuella pygmaea).

Volière type, c’est celle qui abrite les ouistitis pygmées maintenant.


Sur notre gauche, une volière présente des pigeons nicobars (Caloenas nicobarica), avec des roulouls couronnées (Rollulus rouloul).

Cette volière abritait avant la rénovation un rare (Vulnérable) pigeon du Pérou (Patagioenas oenops).
L’autre volière sur notre gauche est celle des spatules, agamis et huppes. On a donc fait le tour!
Pour terminer notre visite, on redescend pour aller observer les gibbons à favoris blancs (Nomascus leucogenys) dans leur volière datant de l’année dernière.
Celle-ci est grande et bien végétalisée, mais les conditions de vie de ces gibbons ne peuvent pas être comparées avec celles de ceux qui vivent sur l’île.



A droite de leur volière, une petite volière abrite des aras araraunas (Ara ararauna).

Voici comment s’achève notre visite du parc de Clères, bien que le visiteur puisse aller voir le chateau, ou les jardins se trouvant devant s’il le souhaite.
Le parc de Clères est un parc atypique, avec un cadre magnifique, et une partie principale qui offre des très bonnes conditions de vie à ses pensionnaires, si l’on exclue le fait que tous les oiseaux sont éjointés. Les volières offrent des conditions un peu moins bonne à la plupart des oiseaux.
J’ai trouvé que la collection, majoritairement axée sur les anatidés et les phasiannidés, s’était un peu appauvri ces dernières années, même s’il y a pas mal d’espèces menacées, et j’espère que maintenant que toute les volières sont rénovées, elle va pouvoir s’étoffer.
Je n’ai pas évoqué la pédagogie, mais les panneaux sont très sommaires, évoquant uniquement le nom de l’espèce et sa répartition la plupart du temps, et aucun panneaux ne permet d’identifier les anatidés du parc (il vaut mieux être un connaisseur!).
Cependant, le parc organise pas mal de journées thématique, avec des animations, et je crois qu’il est très impliqué au niveau des scolaires.
Voilà pour ce compte rendu du parc de Clères.
J’ai essayé d’être objectif, mais, comme je visite le parc trois/quatre fois par an, j’ai tendance à ne plus forcément voir les points noirs, et à être moins objectif. De plus, comme je vois tout le temps ces espèces là, je serais bien incapable de vous dire lesquelles sont rares en captivité, puisque j’ai l’impression de les voir tout le temps!
- orycterope
- Messages: 332
- Enregistré le: Dimanche 02 Juillet 2017 22:17
Re: Parc zoologique de Clères
Merci pour le partage et ces jolies photos, les volières ont l'air assez esthétiques et bien travaillées, çà compense le manque d'espace. La collection est assez classique par contre, peu de grosses raretés, on a globalement des espèces que l'on retrouve dans tous les parcs ornithologiques, à part quelques hoccos et touracos.
- Panda21
- Messages: 2152
- Enregistré le: Mercredi 15 Avril 2009 20:19
Re: Parc zoologique de Clères
Merci beaucoup pour le compte rendu agrémenté de jolies photos.
- Therabu
- Messages: 3918
- Enregistré le: Vendredi 30 Mai 2008 16:10
Re: Parc zoologique de Clères
Merci beaucoup pour ce compte-rendu très clair et toutes ces photos !
Le bras d'eau entre l'île des gibbons de Gabrielle et les visiteurs semble très large, non ?
Le bras d'eau entre l'île des gibbons de Gabrielle et les visiteurs semble très large, non ?
« Les oiseaux ne descendent pas des dinosaures, ce sont des dinosaures à proprement parler. »
Guillaume Lecointre
Guillaume Lecointre
-

gibbon - Messages: 2667
- Enregistré le: Jeudi 10 Mai 2012 11:31
Re: Parc zoologique de Clères
Merci pour vos réponses!
Oui c'est en effet assez large, une dizaine de mètres.
Je me demande en fait, si les îles n'auraient pas été créés au départ uniquement pour les anatidés, puisque les gibbons ont été à une époque lointaine en liberté dans le parc.
Cela pourrait expliquer le fait que l'île soit "mal placé" pour bien observer les gibbons.
Oui c'est en effet assez large, une dizaine de mètres.
Je me demande en fait, si les îles n'auraient pas été créés au départ uniquement pour les anatidés, puisque les gibbons ont été à une époque lointaine en liberté dans le parc.
Cela pourrait expliquer le fait que l'île soit "mal placé" pour bien observer les gibbons.
- orycterope
- Messages: 332
- Enregistré le: Dimanche 02 Juillet 2017 22:17
Re: Parc zoologique de Clères
Clères, "tel Le Phénix qui renait de ses cendres"... Je me rappelle de quelques discussions avec plusieurs directeurs et responsables animaliers, il y a un peu plus d'une quinzaine d'années: ce parc tombe en ruines, ça rouille de partout, la collection n'est pas gérée, ça manque de budget pour fonctionner, etc... Tous prévoyaient sa fermeture à plus ou moins brève échéance. C'était le premier des 4 parcs sous la tutelle du MNHN qui devait tomber définitivement en ruine.
Mais, c'était sous-estimer le Conseil départemental de la Seine-Maritime qui assurait la gestion depuis 1989, d'abord aux côtés du MNHN, puis "seul" depuis le rachat du parc pour l'€uro symbolique le 2 septembre 2013 (et non en 2012, Jules...).
Finalement, c'est de mieux en mieux restauré. Reste encore du travail à faire, notamment, mieux loger cette pauvre de gibbons, car ça jure à côté de celle qui évolue en semi-liberté sur son île, mais c'est sur la bonne voie !!!
Mais, c'était sous-estimer le Conseil départemental de la Seine-Maritime qui assurait la gestion depuis 1989, d'abord aux côtés du MNHN, puis "seul" depuis le rachat du parc pour l'€uro symbolique le 2 septembre 2013 (et non en 2012, Jules...).
Finalement, c'est de mieux en mieux restauré. Reste encore du travail à faire, notamment, mieux loger cette pauvre de gibbons, car ça jure à côté de celle qui évolue en semi-liberté sur son île, mais c'est sur la bonne voie !!!
-

Vinch - Messages: 6084
- Enregistré le: Jeudi 22 Octobre 2009 19:49
34 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Photographier en espace zoologique
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités